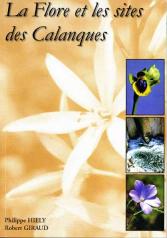XIII
J’ouvris la fenêtre qui donnait sur de petits jardins de pêcheurs et de blanchisseuses encaissés dans le rocher du mont Pausilippe et dans la place de la Margellina.
Quelques blocs de grès brun avaient roulé jusque dans ces jardins et tout près de la maison. De gros figuiers, qui poussaient à demi écrasés sous ces rochers, les saisissaient de leurs bras tortueux et blancs et les recouvraient de leurs larges feuilles immobiles. On ne voyait, de ce côté de la maison, dans ces jardins du pauvre peuple, que quelques puits surmontés d’une large roue, qu’un âne faisait tourner, pour arroser par des rigoles, le fenouil, les choux maigres et les navets ; des femmes séchant le linge sur des cordes tendues de citronnier en citronnier ; des petits enfants en chemise jouant ou pleurant sur les terrasses de deux ou trois maisonnettes blanches éparses dans les jardins. Cette vue si bornée, si vulgaire et si livide des faubourgs d’une grande ville me parut délicieuse en comparaison des façades hautes des rues profondément encaissées et de la foule bruyante des quartiers que je venais de quitter. Je respirais de l’air pur au lieu de la poussière, du feu, de la fumée de cette atmosphère humaine que je venais de respirer. J’entendais le braiment des ânes, le chant du coq, le bruissement des feuilles, le gémissement alternatif de la mer au lieu de ces roulements de voitures, de ces cris aigus du peuple et de ce tonnerre incessant de tous les bruits stridents qui ne laissent dans les rues des grandes villes aucune trêve à l’oreille et aucun apaisement à la pensée.
Je ne pouvais m’arracher de mon lit, où je savourais délicieusement ce soleil, ces bruits champêtres, ces vols d’oiseaux, ce repos à peine ridé de la pensée ; et puis, en regardant la nudité des murs, le vide de la chambre, l’absence des meubles, je me réjouissais en pensant que cette pauvre maison du moins m’aimait, et qu’il n’y a ni tapis, ni tentures, ni rideaux de soie qui vaillent un peu d’attachement. Tout l’or du monde n’achèterait pas un seul battement de cœur ni un seul rayon de tendresse dans le regard à des indifférents.
Ces pensées me berçaient doucement dans mon demi-sommeil ; je me sentais renaître à la santé et à la paix. Beppino entra plusieurs fois dans ma chambre pour savoir si je n’avais besoin de rien. Il m’apporta sur mon lit du pain et des raisins que je mangeai en jetant des grains et des miettes aux hirondelles. Il était près de midi. Le soleil entrait à pleins rayons dans ma chambre avec sa douce tiédeur d’automne quand je me levai. Je convins avec le pêcheur et sa femme du taux d’une petite pension que je donnerais par mois, pour le loyer de ma cellule, et pour ajouter quelque chose à la dépense du ménage. C’était bien peu, ces braves gens trouvaient que c’était trop. On voyait bien que, loin de chercher à gagner sur moi, ils souffraient intérieurement de ce que leur pauvreté et la frugalité trop restreinte de leur vie ne leur permettaient pas de m’offrir une hospitalité dont ils eussent été plus fiers si elle ne m’avait rien coûté. On ajouta deux pains à ceux qu’on achetait chaque matin pour la famille, un peu de poisson bouilli ou frit à dîner du laitage et des fruits secs pour le soir, de l’huile pour ma lampe, de la braise pour les jours froids : ce fut tout. Quelques grains de cuivre, petite monnaie du peuple à Naples, suffisaient par jour à ma dépense. Je n’ai jamais mieux compris combien le bonheur était indépendant du luxe, et combien on en achète davantage avec un denier de cuivre qu’avec une bourse d’or, quand on sait le trouver où Dieu l’a caché.
XIV
Je vécus ainsi pendant les derniers mois de l’automne et pendant les premiers mois de l’hiver. L’éclat et la sérénité de ces mois de Naples les font confondre avec ceux qui les ont précédés. Rien ne troublait la monotone tranquillité de notre vie. Le vieillard et son petit-fils ne s’aventuraient plus en pleine mer à cause des coups de vent fréquents de cette saison. Ils continuaient à pêcher le long de la côte, et leur poisson vendu sur la marine par la mère fournissait amplement à leur vie sans besoin.
Graziella se perfectionnait dans son art ; elle grandissait et embellissait encore dans la vie plus douce et plus sédentaire qu’elle menait depuis qu’elle travaillait au corail. Son salaire, que son oncle lui apportait le dimanche, lui permettait non-seulement de tenir ses petits frères plus propres et mieux vêtus et de les envoyer à l’école, mais encore de donner à sa grand-mère et de se donner à elle-même quelques parties de costumes plus riches et plus élégants, particuliers aux femmes de leur île : des mouchoirs de soie rouge pour pendre derrière la tête en long triangle sur les épaules ; des souliers sans talon, qui n’emboîtent que les doigts du pied, brodés de paillettes d’argent ; des soubrevestes de soie rayée de noir et de vert : ces vestes galonnées sur les coutures flottent ouvertes sur les hanches, elles laissent apercevoir par-devant la finesse de la taille et les contours du cou orné de colliers ; enfin de larges boucles d’oreilles ciselées où les fils d’or s’entrelacent avec de la poussière de perles. Les plus pauvres femmes des îles grecques portent ces parures et ces ornements. Aucune détresse ne les forcerait à s’en défaire. Dans les climats où le sentiment de la beauté est plus vif que sous notre ciel et où la vie n’est que l’amour, la parure n’est pas un luxe aux yeux de la femme : elle est sa première et presque sa seule nécessité.
XV
Quand, le dimanche ou les jours de fête, Graziella ainsi vêtue sortait de sa chambre sur la terrasse, avec quelques fleurs de grenades rouges ou de lauriers-roses sur le côté de la tête dans ses cheveux noirs ; quand, en écoutant le son des cloches de la chapelle voisine, elle passait et repassait devant ma fenêtre comme un paon qui se moire au soleil sur le toit ; quand elle traînait languissamment ses pieds emprisonnés dans ses babouches émaillées en les regardant, et puis qu’elle relevait sa tête avec un ondoiement habituel du cou pour faire flotter le mouchoir de soie et ses cheveux sur ses épaules ; quand elle s’apercevait que je la regardais, elle rougissait un peu, comme si elle eût été honteuse d’être si belle ; il y avait des moments où le nouvel éclat de sa beauté me frappait tellement que je croyais la voir pour la première fois, et que ma familiarité ordinaire avec elle se changeait en une sorte de timidité et d’éblouissement.
Mais elle cherchait si peu à éblouir et son instinct naturel de parure était si exempt de tout orgueil et de toute coquetterie, qu’aussitôt après les saintes cérémonies, elle se hâtait de se dépouiller de ses riches parures et de revêtir la simple veste de gros drap vert, la robe d’indienne rayée de rouge et de noir et de remettre à ses pieds les pantoufles au talon de bois blanc, qui résonnaient tout le jour sur la terrasse comme les babouches retentissantes des femmes esclaves de l’Orient.
Quand ses jeunes amies ne venaient pas la chercher ou que son cousin ne l’accompagnait pas à l’église, c’était souvent moi qui la conduisais et qui l’attendais, assis sur les marches du péristyle. À sa sortie, j’entendais avec une sorte d’orgueil personnel, comme si elle eût été ma sœur ou ma fiancée, les murmures d’admiration que sa gracieuse figure excitait parmi ses compagnes et parmi les jeunes marins des quais de la Margellina. Mais elle n’entendait rien, et, ne voyant que moi dans la foule, me souriait du haut de la première marche, faisait son dernier signe de croix avec ses doigts trempés d’eau bénite et descendait modestement, les yeux baissés, les degrés au bas desquels je l’attendais.
C’est ainsi que, les jours de fête, je la menais le matin et le soir aux églises, seul et pieux divertissement qu’elle connût et qu’elle aimât. J’avais soin, ces jours-là, de rapprocher le plus possible mon costume de celui des jeunes marins de l’île, afin que ma présence n’étonnât personne et qu’on me prît pour le frère ou pour un parent de la jeune fille que j’accompagnais.
Les autres jours elle ne sortait pas. Quant à moi, j’avais repris peu à peu ma vie d’étude et mes habitudes solitaires, distraites seulement par la douce amitié de Graziella et par mon adoption dans sa famille. Je lisais les historiens, les poëtes de toutes les langues. J’écrivais quelquefois ; j’essayais, tantôt en italien, tantôt en français, d’épancher en prose ou en vers ces premiers bouillonnements de l’âme, qui semblent peser sur le cœur jusqu’à ce que la parole les ait soulagés en les exprimant.
Il semble que la parole soit la seule prédestination de l’homme et qu’il ait été créé pour enfanter des pensées, comme l’arbre pour enfanter son fruit. L’homme se tourmente jusqu’à ce qu’il ait produit au-dehors ce qui le travaille au-dedans. Sa parole écrite est comme un miroir dont il a besoin pour se connaître lui-même et pour s’assurer qu’il existe. Tant qu’il ne s’est pas vu dans ses œuvres, il ne se sent pas complètement vivant. L’esprit a sa puberté comme le corps.
J’étais à cet âge où l’âme a besoin de se nourrir et de se multiplier par la parole. Mais, comme il arrive toujours, l’instinct se produisit en moi avant la force. Dès que j’avais écrit, j’étais mécontent de mon œuvre et je la rejetais avec dégoût. Combien le vent et les vagues de la mer de Naples n’ont-ils pas emporté et englouti, le matin, de lambeaux de mes sentiments et de mes pensées de la nuit, déchirés le jour et s’envolant sans regret loin de moi !
XVI
Quelquefois Graziella, me voyant plus longtemps enfermé et plus silencieux qu’à l’ordinaire, entrait furtivement dans ma chambre pour m’arracher à mes lectures obstinées ou à mes occupations. Elle s’avançait sans bruit derrière ma chaise, elle se levait sur la pointe des pieds pour regarder par-dessus mes épaules, sans le comprendre, ce que je lisais ou ce que j’écrivais ; puis, par un mouvement subit, elle m’enlevait le livre ou m’arrachait la plume des doigts en se sauvant. Je la poursuivais sur la terrasse, je me fâchais un peu : elle riait. Je lui pardonnais ; mais elle me grondait sérieusement, comme aurait pu faire une mère.
« Qu’est-ce que dit donc si longtemps aujourd’hui à vos yeux ce livre ? murmurait-elle avec une impatience moitié sérieuse, moitié badine. Est-ce que ces lignes noires sur ce vilain vieux papier n’auront jamais fini de vous parler ? Est-ce que vous ne savez pas assez d’histoires pour nous en raconter tous les dimanches et tous les soirs de l’année, comme celle qui m’a tant fait pleurer à Procida ? Et à qui écrivez-vous toute la nuit ces longues lettres que vous jetez le matin au vent de la mer ? Ne voyez-vous pas que vous vous faites mal et que vous êtes tout pâle et tout distrait quand vous avez écrit ou lu si longtemps ? Est-ce qu’il n’est pas plus doux de parler avec moi, qui vous regarde, que de parler des jours entiers avec ces mots ou avec ces ombres qui ne vous écoutent pas ? Dieu ! que n’ai-je autant d’esprit que ces feuilles de papier ! Je vous parlerais tout le jour, je vous dirais tout ce que vous me demanderiez, moi, et vous n’auriez pas besoin d’user ainsi vos yeux et de brûler toute l’huile de votre lampe. » Alors elle me cachait mon livre et mes plumes. Elle m’apportait ma veste et mon bonnet de marin. Elle me forçait de sortir pour me distraire.
Je lui obéissais en murmurant, mais en l’aimant.