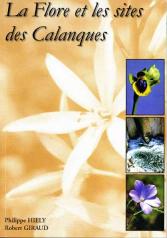Je me souviens de la scène qui lui fit le plus de peine au cœur et dont elle ne se remit jamais complètement.
Elle s’était depuis longtemps liée d’amitié avec deux ou trois jeunes filles à peu près de son âge. Ces jeunes filles habitaient une des maisonnettes dans les jardins. Elles repassaient et raccommodaient les robes d’une maison d’éducation de jeunes Françaises. Le roi Murat avait établi cette maison à Naples pour les filles de ses ministres et de ses généraux. Ces jeunes Procitanes causaient souvent d’en bas, en faisant leur ouvrage, avec Graziella, qui les regardait par-dessus le mur d’appui de la terrasse. Elles lui montraient les belles dentelles, les belles soies, les beaux chapeaux, les beaux souliers, les rubans, les châles qu’elles apportaient ou qu’elles remportaient pour les jeunes élèves de ce couvent. C’étaient des cris d’étonnement et d’admiration qui ne finissaient pas. Quelquefois les petites ouvrières venaient prendre Graziella pour la conduire à la messe ou aux vêpres en musique dans la petite chapelle du Pausilippe. J’allais au-devant d’elles quand le jour tombait et que les tintements répétés de la cloche m’avertissaient que le prêtre allait donner la bénédiction. Nous revenions en folâtrant sur la grève de la mer en nous avançant sur la trace de la lame quand elle se retirait, et en nous sauvant devant la vague quand elle revenait avec un bourrelet d’écume sur nos pieds. Dieu ! que Graziella était jolie alors, quand, tremblant de mouiller ses belles pantoufles brodées de paillettes d’or, elle courait, les bras tendus en avant, vers moi, comme pour se réfugier sur mon cœur contre le flot jaloux de la retenir ou de lui lécher du moins les pieds !
XXX
Je voyais depuis quelque temps qu’elle me cachait je ne sais quoi de ses pensées. Elle avait des entretiens secrets avec ses jeunes amies les ouvrières. C’était comme un petit complot auquel on ne m’admettait pas.
Un soir je lisais dans ma chambre, à la lueur d’une petite lampe de terre rouge. Ma porte sur la terrasse était ouverte pour laisser entrer la brise de mer. J’entendis du bruit, de longs chuchotements de jeunes filles, des rires étouffés, puis de petites plaintes, des mots d’humeur puis de nouveaux éclats de voix interrompus par de longs silences dans la chambre de Graziella et des enfants. Je n’y fis pas grande attention d’abord.
Cependant l’affectation même qu’on mettait à étouffer les chuchotements et l’espèce de mystère qu’ils supposaient entre les jeunes filles excitèrent ma curiosité. Je posai mon livre, je pris ma lampe de terre dans la main gauche, je l’abritai de la main droite contre les bouffées du vent pour qu’elle ne s’éteignît pas. Je traversai à pas muets la terrasse, en assourdissant mes pas sur les dalles. Je collai mon oreille contre la porte de Graziella. J’entendis un bruit de pas qui allaient et venaient dans la chambre, des froissements d’étoffes qu’on pliait et qu’on dépliait, le cliquetis des dés, des aiguilles, des ciseaux de femmes qui ajustaient des rubans, qui épinglaient des fichus, et ces babillages, ces bourdonnements de fraîches voix que j’avais souvent entendus dans la maison de ma mère quand mes sœurs s’habillaient pour le bal.
Il n’y avait point de fête au Pausilippe pour le lendemain. Graziella n’avait jamais songé à relever sa beauté par la toilette. Il n’y avait pas même un miroir dans sa chambre. Elle se regardait dans le seau d’eau du puits de la terrasse, ou plutôt elle ne se regardait que dans mes yeux.
Ma curiosité ne résista pas à ce mystère. Je poussai la porte du genou. La porte céda. Je parus, ma lampe à la main, sur le seuil.
Les jeunes ouvrières jetèrent un cri et s’échappèrent en volée d’oiseaux, se réfugiant, comme si on les avait surprises en crime, dans les coins de la chambre. Elles tenaient encore à la main les objets de conviction. L’une le fil, l’autre les ciseaux, celle-ci les fleurs, celle-là les rubans. Mais Graziella, placée au milieu de la chambre, sur un petit escabeau en bois, et comme pétrifiée par mon apparition inattendue, n’avait pas pu s’échapper. Elle était rouge comme une grenade. Elle baissait les yeux, elle n’osait pas me regarder à peine respirer. Tout le monde se taisait, dans l’attente de ce que j’allais dire. Je ne disais rien moi-même. J’étais absorbé dans la surprise et dans la contemplation muette de ce que je voyais.
Graziella avait dépouillé ses vêtements de lourde laine, sa soubreveste galonnée à la mode de Procida, qui s’entrouvre sur la poitrine pour laisser la respiration à la jeune fille et la source de vie à l’enfant, ses pantoufles à paillettes d’or et au talon de bois dans lesquelles jouaient ordinairement ses pieds nus, les longues épingles à boules de cuivre qui enroulaient transversalement sur le sommet de sa tête ses cheveux noirs, comme une vergue enroule la voile sur la barque. Ses boucles d’oreilles larges comme des bracelets étaient jetées confusément sur son lit avec ses habits du matin.
À la place de ce pittoresque costume grec qui sied à la pauvreté comme à la richesse, qui laisse, par la robe tombante à mi-jambes, par l’échancrure du corsage et par l’entaille des manches, la liberté et la souplesse à toutes les formes du corps de la femme, les jeunes amies de Graziella l’avaient revêtue, à sa prière, des habits et des parures d’une demoiselle française à peu près de sa taille et de son âge dans le couvent. Elle avait une robe de soie moirée, une ceinture rose, un fichu blanc, une coiffe ornée de fleurs artificielles, des souliers de satin bleu, des bas à mailles de soie qui laissaient voir la couleur de chair sur les chevilles arrondies de ses pieds.
Elle restait dans ce costume sous lequel je venais de la surprendre aussi confondue que si elle eût été surprise dans sa nudité par un regard d’homme. Je la regardais moi même sans pouvoir en détacher mes yeux, mais sans qu’un geste, une exclamation, un sourire pussent lui révéler l’impression que j’éprouvais de son travestissement. Une larme m’était montée du cœur. J’avais tout de suite et trop bien compris la pensée de la pauvre enfant. Honteuse de la différence de condition entre elle et moi, elle avait voulu éprouver si un rapprochement dans le costume rapprocherait à mes yeux nos destinées. Elle avait tenté cette épreuve à mon insu, avec l’aide de ses amies, espérant m’apparaître tout à coup ainsi plus belle et plus de mon espèce qu’elle ne croyait l’être sous les simples habits de son île et de son état. Elle s’était trop trompée. Elle commençait à s’en apercevoir à mon silence. Sa figure prenait une expression d’impatience désespérée et presque de larmes qui me révélait son dessein caché, son crime et sa déception.
Elle était bien belle ainsi cependant. Sa pensée devait l’embellir mille fois plus à mes yeux. Mais sa beauté ressemblait presque à une torture. C’était comme une figure de ces jeunes vierges du Corrège clouées au poteau sur le bûcher de leur martyre et se tordant dans leurs liens pour échapper aux regards qui profanent leur pudicité. Hélas ! c’était un martyre aussi pour la pauvre Graziella. Mais ce n’était pas, comme on eût pu croire en la voyant, le martyre de la vanité. C’était le martyre de son amour.
Les habillements de la jeune pensionnaire française du couvent dont on l’avait vêtue, coupés sans doute pour la taille maigre et pour les bras et les épaules grêles d’une enfant cloîtrée de treize à quatorze ans, s’étaient rencontrés trop étroits pour la stature découplée et pour les épaules arrondies et fortement nouées au corps de cette belle fille du soleil et de la mer. La robe éclatait de partout sur les épaules, sur le sein, autour de la ceinture, comme une écorce de sycomore qui se déchire sur les branches de l’arbre aux fortes sèves du printemps. Les jeunes couturières avaient eu beau épingler ça et là la robe et le fichu, la nature avait rompu l’étoffe à chaque mouvement. On voyait en plusieurs endroits, à travers les déchirures de la soie, le nu du cou ou des bras éclater sous les reprises. La grosse toile de la chemise passait à travers les efforts de la robe et du fichu et contrastait par sa rudesse avec l’élégance de la soie. Les bras, mal contenus par une manche étroite et courte, sortaient comme le papillon rose de la chrysalide qu’il fait gonfler et crever. Ses pieds, accoutumés à être nus ou à s’emboîter dans de larges babouches grecques, tordaient le satin des souliers qui semblaient l’emprisonner dans des entraves de cordons noués comme des sandales autour de ses jambes. Ses cheveux, mal relevés et mal contenus par le réseau de dentelles et de fausses fleurs, soulevaient comme d’eux-mêmes tout cet édifice de coiffure et donnaient au visage charmant, qu’on avait voulu en vain défigurer ainsi, une expression d’effronterie dans la parure et de honte modeste dans la physionomie qui faisaient le plus étrange et le plus délicieux contraste.
Son attitude était aussi embarrassée que son visage. Elle n’osait faire un mouvement, de peur de laisser tomber les fleurs de son front ou de froisser son ajustement. Elle ne pouvait marcher tant sa chaussure enclavait ses pieds et donnait de charmante gaucherie à ses pas. On eût dit l’Ève naïve de cette mer du soleil prise au piège de sa première coquetterie.
suite
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40